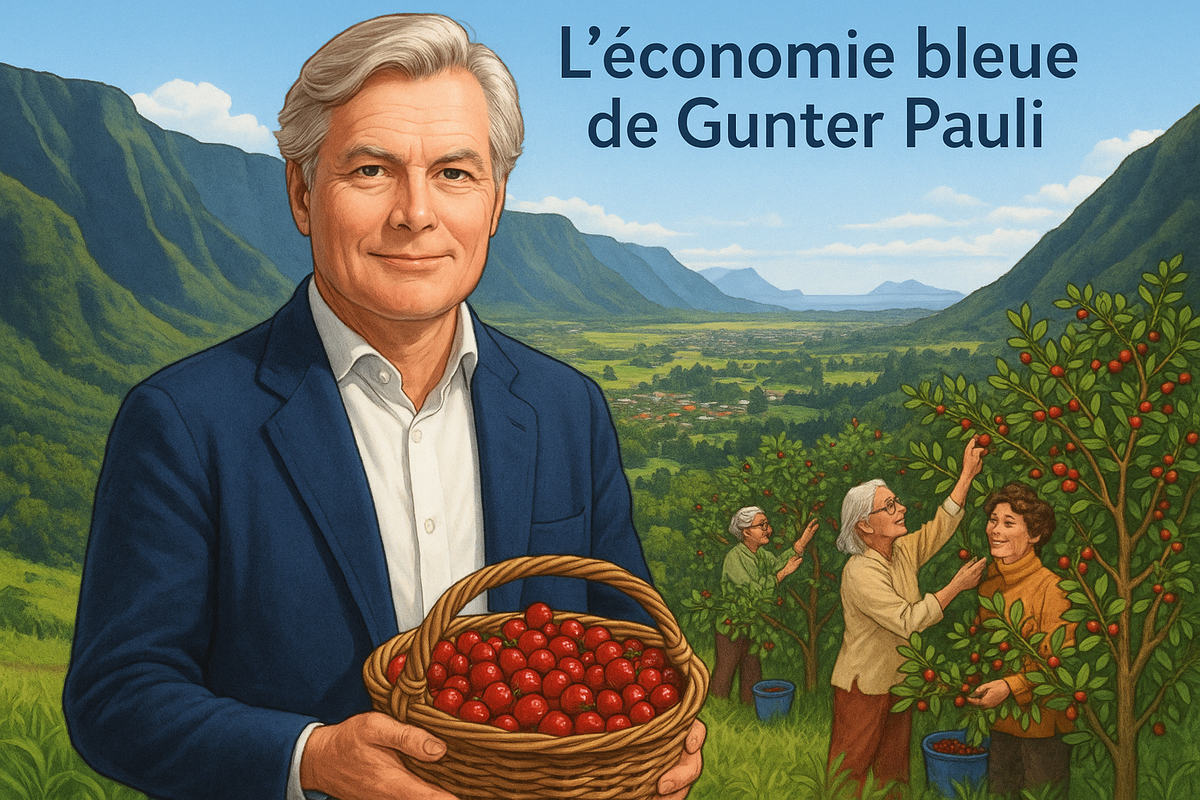Par Didier Buffet
Chaque jour, plus de deux milliards d’êtres humains boivent du café, du thé ou consomment du chocolat. Trois gestes ordinaires. Trois plaisirs sensoriels, presque rituels. Mais derrière ces habitudes se cache une histoire bien plus complexe : celle des routes coloniales, de l’esclavage, des empires, de l’industrialisation et aujourd’hui, de l’inégalité économique mondialisée.
Ces trois produits ont été, dès le XVIIIe siècle, les piliers invisibles d’un modèle de domination planétaire. Et aujourd’hui encore, le rapport de force n’a pas disparu : un producteur africain ou sud-américain gagne quelques centimes par kilo de matière brute, pendant que les multinationales de l’agroalimentaire engrangent des milliards.
À cette histoire, l’économiste belge Gunter Pauli, fondateur de l’économie bleue, oppose une autre vision du monde : circulaire, régénérative, fondée sur la transformation locale et l’intelligence de la nature.
Trois plantes venues d’ailleurs, trois empires en marche
Le thé : de l’Empire céleste à l’Empire britannique
Longtemps monopole chinois, le thé devient un enjeu géopolitique au XIXe siècle. L’Empire britannique, frustré par les restrictions commerciales chinoises, organise la contrebande d’opium et déclenche les guerres de l’opium. Après 1842, la couronne britannique installe la production de thé en Inde coloniale, à Assam et Darjeeling. Le produit devient une institution anglaise — le fameux five o’clock tea — masquant le travail forcé de millions d’Indiens.
Le café : l’arôme amer des révolutions
Originaire d’Éthiopie, le café gagne l’Arabie, puis l’Europe via l’Empire ottoman. À Paris, Vienne ou Londres, il devient la boisson des Lumières et des cafés philosophiques. Mais derrière cette image intellectuelle se cache une réalité brutale : plantations esclavagistes en Haïti, à La Réunion, au Brésil ou en Côte d’Ivoire. L’arôme de liberté ici repose sur la servitude là-bas.
Le chocolat : sucre, travail et oubli
Originaire d’Amérique centrale, le cacao est une boisson sacrée chez les Mayas. Mais son goût amer séduit peu les palais européens. Ce sont les Belges qui, au XIXe siècle, sous le règne de Léopold II, le transforment. En exploitant le Congo pour produire en masse, ils créent une version sucrée et lactée. Le carré de chocolat, proposé avec chaque tasse de café ou de thé, devient un rituel européen — et un alibi de douceur pour masquer la violence de sa chaîne de production.
Gunter Pauli et l’économie bleue : tout est ressource
L’économie bleue, à la différence de l’économie verte, ne cherche pas seulement à moins polluer. Elle s’inspire du vivant, dans lequel rien ne se perd : chaque résidu devient matière première.
L’exemple du café
Sur un caféier, seuls 0,2 % de la biomasse servent à produire la boisson ! Le reste — pulpe, marc, fleurs, écorce, bois — est souvent jeté. Pourtant, tout est valorisable :
- Le marc : substrat pour cultiver des pleurotes, ingrédient pour cosmétiques, base d’extraits antioxydants, matériau isolant.
- La pulpe (cascara) : source de jus, tisanes énergisantes, aliments riches en fibres.
- La fleur : infusion haut de gamme au parfum délicat.
- Le bois : objets artisanaux, manches, charbon végétal.
Le cacao aussi
La pulpe de cabosse, riche en sucres, peut être fermentée en jus ou alcool. Les cosses sont transformables en farine, tisanes, fertilisants. Le beurre de cacao sert à l’alimentation, mais aussi à la cosmétique.
L’idée de Pauli est simple : une plante = un écosystème entrepreneurial. Chaque partie, chaque étape de transformation peut créer de la valeur locale, des emplois, et une autonomie économique.
Sortir de la logique coloniale : produire ET transformer sur place
Aujourd’hui encore, les pays tropicaux exportent leur matière brute, sans la transformer. Le “commerce équitable” améliore un peu les conditions, mais ne remet pas en cause le modèle économique.
L’économie bleue propose l’inverse : créer sur place une chaîne complète, de la production à la transformation, en impliquant la population locale. Par exemple :
- Une coopérative transforme la pulpe de café en boisson pétillante.
- Des jeunes cultivent des champignons sur marc de café.
- Des artisans créent des meubles avec le bois de taille.
- Des femmes récoltent les fleurs pour en faire des infusions de luxe.
Résultat ? Plus de revenus, moins de dépendance, plus de fierté.
Et nous, dans tout ça ?
Nos choix de consommation sont rarement neutres. Choisir un café ultra-transformé, issu d’une marque industrielle, c’est soutenir un modèle déséquilibré. À l’inverse, acheter un café produit ET transformé localement, un chocolat élaboré à partir de fèves fermentées sur place, un thé issu d’un petit producteur… c’est encourager un monde différent.
Nos tasses racontent une histoire. Il est temps d’y infuser un avenir plus juste.
Et quid du goyavier de La Réunion ?
Ce que Günther Pauli démontre avec le café peut s’appliquer à d’autres plantes. Un exemple tropical criant : le goyavier de Chine (Psidium cattleianum), abondant à La Réunion.
1. La pulpe, délice local
Le fruit rouge ou jaune est acidulé, parfumé, sucré. On en fait des jus, nectars, glaces, confitures, pâtes de fruits, sirops— autant de produits transformables sur place et exportables.
2. Les graines & mucilage
Riches en pectines, fibres, flavonoïdes et antioxydants, elles sont exploitables pour :
- les cosmétiques naturels (gels, exfoliants, sérums),
- les compléments alimentaires,
- les texturants alimentaires ou pharmaceutiques.
3. Les feuilles
Utilisées en tisanes médicinales, elles possèdent des propriétés anti‑diarrhéiques, digestives, anti‑diabétiques et même antibactériennes. Un segment bien-être en expansion.
4. Le bois
D’une densité exceptionnelle, il est prisé pour :
- des meubles rustiques,
- des objets artisanaux,
- des ustensiles agricoles ou culinaires.
À La Réunion, certaines communes (comme la Plaine-des-Palmistes) l’utilisent pour l’artisanat local. Le bois devient ressource, pas déchet.
5. Un écosystème complet
Le goyavier :
- pousse en altitude sans engrais,
- attire les abeilles,
- protège les sols,
- permet une culture associée avec la vanille, les épices ou les plantes médicinales.
Vers une économie bleue insulaire
| Ressource | Produits | Filières |
|---|---|---|
| Pulpe | Jus, confiture, sorbet | Agroalimentaire |
| Graines/mucilage | Sérums, exfoliants, compléments | Cosmétique/santé |
| Feuilles | Infusions médicinales | Phytothérapie |
| Bois | Mobilier, outils, objets d’art | Artisanat |
| Fleurs | Miel, tisanes, déco, cosmétique | Divers |
Le goyavier, tout comme le café, offre une multitude de produits dérivés, sans gaspillage. Il devient un modèle réunionnais d’économie bleue, conjuguant :
- durabilité,
- autonomie locale,
- valorisation identitaire.
Boire du café, du thé, manger du chocolat, ou cueillir un goyavier, c’est accomplir un geste anodin. Mais ce geste, selon la manière dont il est inscrit dans une chaîne de valeur, peut être le reflet de la domination… ou de l’émancipation.
Gunter Pauli nous propose une vision positive, ouverte, pragmatique : transformer nos ressources locales en pôles d’innovation, recréer de la richesse sans prédation, réconcilier nos plaisirs avec l’équité.
Ce qui est possible avec le café l’est avec le goyavier. Et demain, avec la banane, le tamarin, l’ananas, ou toute autre plante tropicale.
À La Réunion, comme ailleurs, la révolution bleue commence dans les gestes les plus simples.
Souhaitez-vous une version créole réunionnais, ou un extrait en style poétique ?