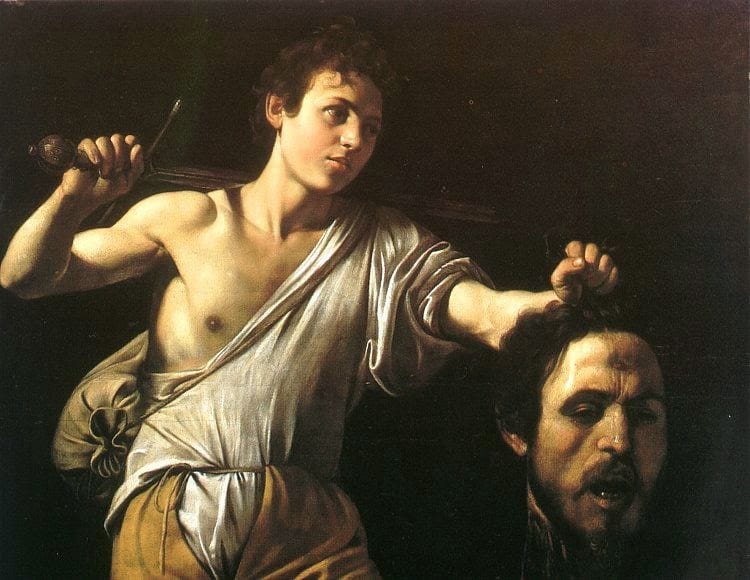Le mal a changé de visage
Il ne hurle plus dans les ténèbres. Il ne porte plus l’uniforme, ni la croix gammée, ni même le masque du dictateur classique. Le mal contemporain s’est glissé dans les plis de notre quotidien. Il est devenu ordinaire, fonctionnel, économique. Et c’est bien là ce qui le rend si redoutable.
Depuis Hannah Arendt et son concept de "banalité du mal", nous savons que l’inhumain peut se cacher derrière la soumission à l’autorité, l’obéissance aux procédures, la neutralité apparente de ceux qui "ne font qu’exécuter". Le fonctionnaire nazi Adolf Eichmann n’était pas un monstre sanguinaire, seulement un rouage zélé. Il n’exprimait aucune haine : seulement une absence de pensée.
Les expériences de Stanley Milgram l'ont confirmé. Des individus ordinaires, sans malice particulière, acceptaient de faire souffrir leurs semblables pourvu qu’une autorité leur en donne l’ordre. La souffrance de l’autre devenait une abstraction, dissolue dans la mécanique du protocole.
Ce glissement vers l’indifférence est peut-être le premier visage du mal moderne : non pas le crime passionnel, mais l’extinction de la responsabilité individuelle dans des systèmes complexes.
Mais un autre mal, plus vaste, plus structurel, a pris le relais. Celui d’un système économique où la logique financière prime tout. Un système qui ne tue pas par cruauté mais par calcul, qui ne fait pas souffrir pour dominer, mais pour optimiser. L’homme devient variable d’ajustement, le vivant une ressource à extraire, la planète un actif à rentabiliser.
Ce capitalisme financiarisé n’est plus l’allié du progrès social qu’il fut aux XIXe et XXe siècles. Il s’est autonomisé. Il échappe aux lois, aux nations, aux volontés populaires. Il investit dans des technologies qui ne servent plus l’humain, mais le remplacent. L’intelligence artificielle, la robotisation, les plateformes numériques ont cessé d’être des outils d’émancipation : elles sont devenues des instruments de dépossession.
Le mal aujourd’hui n’est plus dicté par la haine des autres. Il résulte de l’oubli du bien commun. Et de la disparition d’un cadre moral commun.
Avec le recul des religions dans les sociétés occidentales, c’est une forme de transcendance qui a disparu. Mais ce n’est pas le fait de croire en Dieu qui importe ici. C’est ce que ce Dieu représentait : une limite, une exigence, une verticalité. En son absence, la morale républicaine aurait pu prendre le relais. Mais elle semble elle aussi affaiblie, technocratisée, fragmentée.
Le philosophe Marcel Conche disait que l’homme est un animal métaphysique. Il a besoin de sens, de repères, de finalité. Sans cela, tout devient relatif. Tout devient possible. Et parfois, tout devient permis.
Le scientifique Axel Kahn, disparu en 2021, incarnait cette résistance morale sans transcendance religieuse. Il alertait sur l’euthanasie, non pas par conservatisme, mais parce qu’il voyait dans cette tentation une pente glissante vers l’utilitarisme radical. Une société qui programme la mort au nom de la compassion peut rapidement oublier ce que vivre signifie. Le mal moderne n’est pas toujours brutal : il est parfois enveloppé de bons sentiments.
Alors que faire ? Refuser le nihilisme. Refuser l’idée que "tout se vaut", que "le monde est ainsi", que "nous n’y pouvons rien". Ce fatalisme confortable est une forme de renoncement.
Il ne s’agit pas de restaurer une morale religieuse autoritaire. Il s’agit de retrouver une morale humaine, exigeante, lucide. De redonner sens au mot "responsabilité". De faire revivre l’idée de justice, non comme slogan, mais comme exigence réelle.
Le mal aujourd’hui n’est pas un démon extérieur. Il est en nous, dans nos silences, dans nos renoncements, dans nos excuses. Il est aussi dans nos systèmes, dans les normes que nous acceptons, dans les lois que nous n’interrogeons plus.
Il faut recommencer à penser. À juger. À refuser. À désobéir parfois.
Et peut-être alors, comme le suggérait Nietzsche, imaginer un homme nouveau. Pas un surhomme dominateur, mais un homme debout, capable de porter sa propre loi, et de répondre du monde qu’il laisse aux autres.